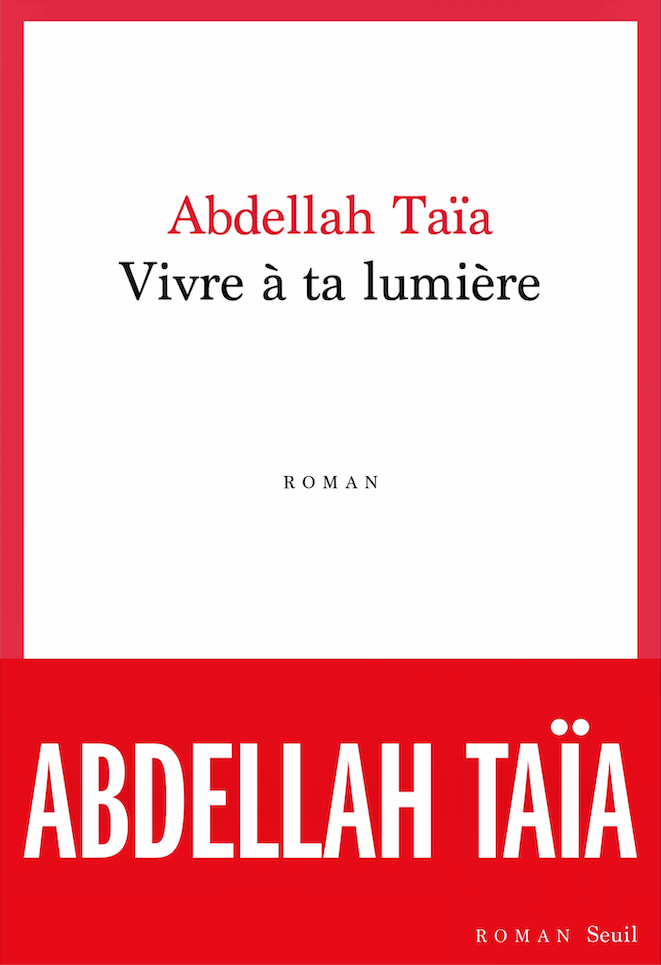Abdellah Taïa : « Le désir d’écrire sur ma mère est en moi depuis longtemps »
Dans son nouveau roman, « Vivre à ta lumière », Abdellah Taïa, l'un des rares auteurs arabes à avoir publiquement évoqué son homosexualité, a choisi de raconter trois moments dans la vie d'une femme, Malika, sa mère. Entretien.
En 2016, alors qu’il avait été choisi pour être rédacteur en chef d’un jour de Yagg, Abdellah Taïa, écrivait ceci à propos de son métier d’écrivain : « Ecrire c’est s’engager. Sérieusement s’engager. Je le sais depuis le départ. Ecrire avec des théories, ce n’est pas pour moi. Ecrire en partant du monde et de ses réalités bien concrètes, oui et oui. »
Pour son 12e roman, Vivre à ta lumière (aux éditions du Seuil), Abdellah Taïa a choisi de raconter trois moments dans la vie d’une femme (de 1954 à 1999). Dans trois villes distinctes : Béni Mellal, Rabat puis Salé. Cette femme, Malika, c’est la mère de l’auteur, décédée en 2010. Une femme présentée comme maîtresse de son destin, veuve à 20 ans, son premier mari, qu’elle avait choisi, décédé en Indochine, une guerre dans laquelle la France coloniale a entraîné tant de soldats venus des territoires africains occupés. Comme dans ses précédents romans récents (on pense en particulier à La Vie lente et à Un pays pour mourir), Abdellah Taïa jette sur le papier des phrases, courtes, cinglantes, comme autant de coups de poing. Vivre à ta lumière est un récit puissant. Abdellah Taïa a répondu aux questions de Komitid dans un long entretien où il évoque sa mère, le vécu dans une société post-coloniale et l’évolution de son écriture. Sans oublier Billal Hassani, dont il est un grand fan !
Komitid : Qu’est-ce qui a déclenché cette envie de raconter l’histoire de votre mère ?
Abdellah Taïa : Le désir d’écrire sur ma mère est en moi depuis longtemps. Cette femme a fait une œuvre pour elle et pour nous. Elle est passée de la pauvreté noire de la campagne marocaine des années 50, à la construction d’une maison à Salé, près de Rabat. Puis gérer un mari, faire venir au monde dix enfants, les aider à faire des études. Et pendant tout ce temps, elle avait des tas de guerre à mener en même temps. Et elle n’a pas arrêté de parler, de manger. Le désir est inscrit en moi dès que j’ai eu la capacité d’écrire. Pourquoi suis-je passé à l’acte ? C’est arrivé durant les funérailles de ma mère en août 2010. Deux bombes ont sauté dans ma tête et dans mon cœur : on n’accepte pas que la mère meurt c’est impossible. Mon père était mort en 1996 et j’ai compris que j’étais seul au monde. Mais c’est seulement en 2010 à la mort de ma mère que j’ai compris ce que veut dire au fond la destinée d’un gay dans ce monde, dans cette société. Il y a une forme de solitude terrible et la société le force à aller dans cette solitude. Mes frères et sœurs avaient leur propre organisation, leur propre structure et moi j’étais seul. Pendant les funérailles, une de mes sœurs s’est mise à parler du premier mari de ma mère, envoyé en Indochine. Même moi, je n’avais pas eu la générosité de m’intéresser de manière profonde à la vie de ma mère et je n’étais pas au courant de cette histoire. Que la France avait pris le mari de ma mère pour l’envoyer loin, je n’arrive même pas à imaginer ce que ça a dû être pour eux. Là j’ai ressenti une forme de honte, je peux être généreux avec beaucoup de monde et je ne l’ai pas été avec ma mère et il faudrait réparer cela. C’est pour cela que je commence le roman avec cette histoire. A la mort de son mari, sa belle famille a reçu une indemnité de l’Etat français… et ma mère a été jetée à la rue, en pleine colonisation française. C’est à partir de cette honte que j’ai décidé d’écrire ce livre dans lequel il n’y aura qu’elle et sa voix.
Vous avez composé ce roman en trois parties, correspondant à trois villes. Comment est venu ce choix, de Béni Mellal, Rabat et Salé ?
Cela correspond à ma façon d’écrire, le style fragmentaire, elliptique, à l’os. Je n’ai plus besoin de faire la danse du ventre, d’essayer d’amadouer le public. Le fait de choisir des moments, je parle plutôt de fragments et essayer de les mettre ensemble, c’est toujours ce que j’ai fait. Il y a ces trois fragments et entre eux, le vide. C’est la même chose en littérature qu’au cinéma : il y a ce que tu montres et ce que tu ne montres pas. Ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Vivre à ta lumière, c’est la même structure que pour mon film L’Armée du salut, qui était trois moments de la vie d’un gay marocain. Tout repose sur l’instant tragique, tragique et poétique, qu’on choisit de montrer. J’écris toujours avec cette idée qu’il ne faut pas tout donner et qu’il ne faut même pas donner l’impression que c’est un écrivain qui écrit. Il faut faire oublier tout ça.
Dans de nombreux romans, vous présentez des personnages très forts et qui s’affrontent. Je pense en particulier à Mme Marty et Mounir dans « La Vie lente ». Dans la trois partie de ce roman, il y a Malika et Jafar, ce jeune homo voleur. Qu’est-ce qui t’intéresse dans ces relations ?
Il y a quelque chose de la confrontation et même du règlement de compte. J’assume. Mais je n’écris pas pour que tel ou tel personnage ait justice et que ce soit lui qui sorte vainqueur. Je n’écris jamais pour que quelque chose soit résolu ou qu’il y ait une ligne narrative simple. Je crois que la littérature est faite pour qu’une voix s’exprime et en exprimant donne à entendre une autre voix à l’intérieur de cette voix. Et une voix qui porte à une autre voix. Et un personnage qui porte l’histoire d’un autre personnage. Le gay que je suis aujourd’hui, à 48 ans, je ne peux pas dire que c’est uniquement pour avoir lu Jean Genet, Oscar Wilde ou Marcel Proust, qui m’ont aidé à construire mon identité gay. Dans ma famille pauvre, j’ai vu cette femme. Comment elle a enlevé toute la saleté que la société lui jetait sur la figure et le corps et comment elle passait tout le temps à inventer des histoires pour manger la cervelle des gens, comment elle déjouait ce système dans laquelle cette femme pauvre était enfermée. A chaque fois qu’elle revenait à la maison, elle « débriefait » devant nous, pas pendant 10-15 minutes mais des jours durants ! Il y a une chose qu’elle m’a donnée, c’est qu’elle ne se présentait pas à nous comme quelqu’un de bien ou quelqu’un d’honnête. L’honnêteté c’est pour les bourgeois et ceux qui peuvent se permettre d’être honnêtes. Nous, on a comme seule solution que de faire semblant qu’on est soumis à eux alors qu’on ne l’est pas.
Vous parlez aussi de sa dureté…
Je ne voulais pas montrer quelqu’un qui va susciter une forme d’empathie immédiate et facile. Je voulais que le personnage de Malika soit à la hauteur de ce que cette femme a eu comme stratégie pour survivre. Pour survivre on ne peut pas être tout le temps dans la gentillesse. Il faut bien réfléchir sur ce qu’on dit aux gens pour qu’ils ne vous abattent pas. Pour cela, il faut être largement conscient des enjeux du monde, même quand vous êtes une femme « analphabète ».
« Tourner la page sans la lire, c’est aussi appeler les gens à l’amnésie, c’est installer le silence, l’oubli et c’est une forme d’injustice »
Dès les premières pages, frontalement, la question du colonialisme est présente. Depuis 20 ans que vous écrivez, avez-vous vu une évolution dans le regard porté sur cette période ?
Ce qui change, c’est que les nouvelles générations de jeunes arabes et africaines ont fait le lien entre leur vie et le colonialisme. Elles ont compris que nous vivons encore dans des pays arabes et africains dans lesquels les constructions sociales et politique ont été inventées et réinventées par le système colonial. Comme si, un peu à la façon du général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale on avait incité tout le monde à tourner la page. Mais tourner la page sans la lire, c’est aussi appeler les gens à l’amnésie, c’est installer le silence, l’oubli et c’est une forme d’injustice. Aujourd’hui, il y a un réveil des jeunes qui vivent en France ou au Maroc ou ailleurs. Mais souvent on leur rétorque : ah mais tu en est encore là ? Comme si la colonisation s’était arrêtée il y a deux siècles. Il y avait comme une forme de censure, une demande qui nous était faite d’être nous aussi puissants, comme si, même après le colonialisme, l’occident ne continuait pas à dominer le reste du monde, par la puissance financière et politique et par le soft power évidemment. Pour ce roman, je voulais raconter la vie de cette femme qui commence durant le colonialisme. Cette femme a eu à affronter le système colonial et non seulement, cela a eu des conséquences extrêmement tragiques pour elle mais cela l’a aussi poussée à révéler en elle la possibilité de mener la guerre. Dans tout le livre, elle parle et elle est parfois dans le délire mais elle est surtout toujours en action. Elle n’est pas du tout en train de se victimiser, elle n’essaie jamais de se ramener elle-même à son statut de femme pauvre qui ne peut rien faire. La France est présente dans les trois parties. Et je voulais qu’il y ait, notamment dans la troisième partie, le point de vue de cette femme sur la liberté et où placer la liberté aujourd’hui. Et pourquoi dans notre monde, elle est associée systématiquement à l’Occident. Le Maroc ne semble exister que depuis que Delacroix a parlé de sa lumière, puis Matisse, Paul Bowles, Francis Bacon. Nous, nés au Maroc, nous pouvons en parler, mais ce n’est validé que si c’est une personne occidentale qui en parle. C’est de cela dont parle le livre et le titre.
« Je n’en ai pas encore fini avec l’écriture ! »
Comment abordez-vous l’écriture après 20 ans de travail ?
J’écris toujours la même chose, c’est le même rapport au monde, les mêmes thèmes. Malgré les études de littérature française que j’ai faites, malgré les mémoires sur Guy de Maupassant, Marcel Proust et Fragonard, je dirais que toute cette partie-là de mon travail n’a pas eu de prise sur mon cerveau. Je peux parler de Proust mais dès que j’écris, je l’oublie. Il y a quelque chose qui vient de plus loin et qui ne demande qu’à sortir. Heureusement que j’ai vécu avec 11 personnes et j’étais le neuvième : il y avait les voix de mes sœurs, leurs rêves, leur vie, celle de ma mère. J’ai des tonnes et des tonnes de choses que je peux dire à travers moi ou alors moi entrer dans leurs histoires, leurs vies, et les dire. Je n’en ai pas encore fini avec l’écriture ! J’ai même l’impression que le fait d’écrire un livre et de le publier, me révèle ce que je dois encore écrire.
Virginie Despentes a annoncé créer sa maison d’édition et fait partie du collectif #StopBolloré contre le rachat d’une grande partie de l’édition français par l’homme d’affaires breton Vincent Bolloré. Que pensez-vous de cette initiative ?
Cette domination des puissances d’argent ne m’étonne pas. Nous aimons la France mais il faut être juste, clairvoyant, critique et lucide. Malheureusement, c’est ce qui se passe en Occident en ce moment. Il y a le discours sur les droits humains, qui est très vite consommé par la mode. On voit que ce discours devient très vite de la fausse émancipation, ce que Fassbinder a très bien analysé dans tous ses films dans les années 70 et 80. On vit encore dans ce qu’il avait prédit. Heureusement, dès que je suis arrivé en France, j’ai appelé plusieurs personnes et René de Ceccaty a eu la générosité de m’accueillir dans son bureau aux éditions du Seuil. Ce n’est pas lui qui m’a fait entrer au Seuil mais mon premier roman, L’Armée du salut, a été accepté par leur comité de lecture. Les éditions du Seuil sont indépendantes, encore de gauche, et elles défendent des valeurs de gauche. Et pour moi ce n’était pas un choix de hasard. Ils avaient publié Kateb Yacine, le grand écrivain algérien ou encore la traduction de Tahar Bel Jelloul du Pain nu de Mohammed Choukri. Je suis au Seuil et je resterai au Seuil.
Comment voyez-vous cette période pré-électorale, dans laquelle on a en particulier des candidats ouvertement racistes ?
Je me souviens de l’entre deux tours de 2012 avec les attentats à Toulouse. Comme si le vrai visage de certains s’était révélé et qui est ressorti quelque temps après avec le « mariage gay », qui n’a depuis pas cessé de se manifester et qui devient le thème dominant. Tous les jours, je me dis : quoi répondre ? Il faut répondre mais il faut tout faire pour qu’on ne nous fasse pas du mal. J’ai déjà dit beaucoup de choses dans mes livres. La critique est claire, en particulier dans La Vie lente. Il faut essayer de ne pas retourner dans la peur, et c’est tragique car cela me renvoie à mon adolescence où je devais toujours penser quoi dire pour qu’on ne me fasse pas de mal. Aujourd’hui, c’est quoi dire face à la boulangère qui vote FN pour qu’elle ne vous jette pas un regard qui va détruire toute la poésie que vous allez ressentir dans votre journée ? Quoi dire quand vous marchez dans la rue et que tout d’un coup, vous sentez qu’on dépassant quelqu’un, celui-ci vérifie que vous ne lui avez pas volé quelque chose ? Quoi dire quand vous voyez des gens regarder des femmes voilées de manière trop insistante et effrontément dans le métro ? Et cela tous les jours. Quoi dire, quoi faire ? Parler ou ne pas parler ? C’est très tragique. Ce que j’ai fait, publier 12 livres au Seuil, traduits en plusieurs langues, pour moi, c’est énorme mais l’écho dans la société française de ma voix ? C’est minime… Mais je le dis quand même !
Lors de notre dernier entretien, vous nous aviez confié que vous admiriez beaucoup Bilal Hassani et que vous aimeriez le rencontrer. C’est fait ?
Non. Je lui ai envoyé un message par Instagram mais il ne m’a pas répondu. Je voulais justement lui envoyer Vivre à ta lumière, parce qu’il parle beaucoup de sa mère et c’est très touchant. Ce n’est sans doute pas lui qui gère la page et je n’ai pas su comment entrer en contact avec lui. Je le suis toujours. Il est plus grand que la France, Bilal Hassani. Je crois qu’on ne se rend pas bien compte de tous les tabous et les barrières qu’il ne cesse de briser. On essaie juste de le ramener à quelque chose de petit. Mais ça va tellement plus loin et c’est surtout plus magique. C’est quelqu’un de magique.
Ecrire sur votre mère, est-ce que sur un plan personnel cela vous a fait du bien ?
Il s’est passé quelque chose quand j’ai terminé le livre l’été dernier. Il y avait plein d’amis autour de moi que je connaissais depuis plus de 20 ans. Ils ne s’intéressaient plus à moi, ils ne m’appelaient plus. J’étais un peu leur Sigmund Freud, mais désormais ils ne s’intéressent à moi que pour « l’élévation » culturelle de leur propre enfant. Même nos amis hétérosexuels ne pensent pas à nous. J’ai écrit des lettres de rupture, des lettres guillotines comme je sais le faire. Depuis l’été dernier, j’ai réalisé que je n’avais pas créé de fratrie gay, de famille gay et je suis en train de la fabriquer avec la même volonté que ce que j’ai donné à ces hétérosexuels qui ne le méritaient pas. Je vais donner à tous ces homos, lesbiennes, personnes LGBT qui vont comprendre ce que je suis en train de te raconter. Les mots « Rupture » et « Réparation », je comprends enfin ce que cela signifie.
« Vivre à ta lumière », d’Abdellah Taïa, éditions du Seuil, 208 p., 18 euros